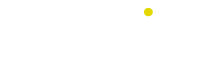Le partenariat a depuis plus d'une vingtaine d'années pris une place prépondérante dans la conduite de projet de recherche, d'innovation, d'industrialisation et même d'internationalisation. Cette vague s'est vite propagée dans le domaine du financement de l'innovation. Aujourd'hui, il est devenu quasi-obligatoire d'intégrer une composante collaborative à son projet pour être financé au niveau Européen et dans une moindre mesure au niveau national. PCRD-H2020, Eureka, Fast Track To Innovation, Eurostar, PSPC, etc. Nombreuses sont les aides, mais elles requièrent trois choses au préalable : de constituer un consortium, de le structurer et de l'animer. Rien de bien aisé ! Tout du moins a priori.
Étape 1 : identifiez les besoins de votre projet
Tout d'abord, il est de bon ton de signaler que tout porteur de projet doit répondre à une question avant tout investissement ou demande de financement public comme privé :
"Quels sont les verrous scientifiques et/ou techniques que lève mon projet de recherche ?"
Cette question est clé ! Ne dit-on pas que "ce qui se conçoit bien s'énonce clairement" ? Une réponse claire le plus tôt possible permettra au porteur de formaliser son projet de R&D beaucoup plus rapidement. D'autant plus que l'ampleur des travaux à mener, leurs coûts, les compétences nécessaires à mobiliser et même les retours à espérer du projet varient en fonction de la nature de ces verrous.
Une fois menée, cette réflexion doit se concrétiser sous forme d'un Executive Summary non confidentiel potentiellement diffusable aux organismes-financeurs mais aussi aux partenaires de recherches pressentis. Garder en tête que ce résumé, quel que soit son format, servira de carte d'identité au projet et doit donc permettre de communiquer simplement sur ce dernier en précisant le concept du projet, les verrous qu'il lève, les porteurs, ainsi que les retombées économiques et sociétales attendues.
Cette première étape permet de "due diligenter" le projet : analyser les besoins (budgets, compétences, temps) inhérents à l'atteinte des objectifs fixés. Un regard franc notamment sur les compétences est un prérequis pour que vous vous entouriez de partenaires pertinents qui compléteront votre expertise.
Pour cela, vous devez établir un profil-type des partenaires souhaités en mettant l'accent sur leurs compétences, leur rôle dans le projet, leur secteur d'activité, le montant estimé de leur participation financière et leur lieu d'implantation.
Étape 2 : mobilisez votre réseau et ouvrez vos recherches à l'extérieur
Rendu à la recherche de partenaires, la première voie à explorer est votre propre portefeuille de contacts, y compris vos sous-traitants et clients.
En tant que porteur, vous êtes le plus apte à identifier au sein de votre entourage des organisations potentiellement adéquates pour intégrer votre projet de recherche. Le montage de projet sera d'autant facilité que vous aurez une bonne maîtrise de votre environnement et une forte capacité à mobiliser les acteurs. Et cela est principalement dû au fait qu'au cours d'un projet, il y a généralement un lien de confiance qui se crée entre partenaires. Lorsque vous mobilisez des acteurs avec qui ce lien préexiste, vous assurez une plus forte efficacité et durabilité au partenariat.
Les recherches sur le consortium-optimal montrent qu'en plus du lien de confiance, plusieurs facteurs sont déterminants dans l'efficacité des collaborations de recherche :
La similarité cognitive qui assure que les interactions entre partenaires se fassent sur la base d'un langage technique et scientifique compréhensible de tous, surtout pour les questions techniques les plus complexes. Une sémantique commune assure le minimum d'amalgames lors de la conduite du projet et donc réduit le risque de tensions ou de coûts subsidiaires.
Des objectifs concertés quant à la finalité du projet. Ce point est névralgique surtout pour les collaborations public-privé mobilisant des acteurs avec des objectifs différents et potentiellement divergents (académiques : améliorer les connaissances dans le domaine, versus entreprises : développer un solution profitable).
Néanmoins, pour disrupter, il faut quand même conserver un degré d'hétérogénéité entre acteurs ; cela assure une prise en compte de l'ensemble des prismes du projet via un regard diversifié sur la problématique. Il faut donc une complémentarité entre acteurs assurant la flexibilité, la stabilité et l'ouverture dans le projet.
Récemment, notre équipe a mené une étude économétrique pour analyser la structure des consortiums financés par la Commission européenne. Les résultats montrent que les les consortiums les plus efficaces en temes d'innovation et de dépôts de brevet sont très hétérogènes (47% privé, et 53% public) tandis que les moins efficaces étaient ceux parmi lesquels il y avait prédominance d'un type d'organisation. De plus, il semble que plus le projet est d'envergure (multi-pays et multipartenaires) et prévoit des contributions de chaque partenaire homogènes (durée et budget) et plus le partenariat s'avère efficace in fine.
Vous devez donc garder ces points en mémoire et vous entourer d'entités répondant à ces critères. Une fois vos contacts sondés, si le consortium n'est pas complet vous pouvez ouvrir à des organismes extérieurs. Pour cela, reposez-vous sur les moteurs de recherche et bases de données institutionnels (Réseau Entreprise Europe, CORDIS, Eureka, PCN,...). Ces dernières conglomèrent organismes de recherche, entreprises, universités, associations exerçant dans divers domaines de recherche et d'innovation. Vous pôuvez aussi contacter les pôles de compétivité français et étrangers pour sonder leur liste d'adhérents. L'objectif est d'avoir des noms de contacts pertinents qui pourront soit aboutir directement à un partenariat soit vous rediriger vers d'autres entités.
Étape 3 : discutez le projet et négociez vos contrats de partenariat
Dans une autre mesure, la participation à des « brokerage events », salons dédiés et meetups peuvent aussi vous permettre de rencontrer les interlocuteurs de visu, d'échanger, posant ainsi les bases de relations potentiellement fructueuses. Armé de votre Executive Summary et d’accords de confidentialité, vous pourrez échanger de manière libre et sécurisé autour du projet et de son montage.
Le rôle accordé à chacun doit être discuté ainsi que la répartition des tâches, budget et temps à allouer au projet. A mesure des réunions, conférences téléphoniques et mails, le projet se structurera de manière consensuelle. Plus les partenaires intègreront le projet tôt, participant ainsi à cette structuration, moins le risque de litige, de défection ou de rejet du projet sera élevé.
Doivent donc être initiées des accords de consortium reprenant les éléments techniques du projet (répartition des tâches en lots et répartition de ces lots entre partenaires), les règles de décision, les propriétés intellectuelles et financières des résultats ainsi que leurs conditions de publication et d’exploitation.
Étape 4 : parez-vous aux aléas
Dans l’optique d’être financé par un organisme public, vous devez bien prendre en compte les critères d’éligibilité imposés. La position de coordinateur doit être notamment discutée car elle requiert que l’organisme désigné anime le consortium (organisation de réunion, gestion administrative, rédaction de rapport de suivi, contacts réguliers avec les financeurs, négociation et résolutions de potentiels conflits, …). Il se peut que le porteur originel du projet ne soit pas celui déclaré lors de la demande de subvention, ce dernier ne souhaitant pas ou n’ayant pas les capacités pour mener ces tâches tout le long du projet.
D’autre part, le plus gros aléa qui puisse survenir est la défection d’un ou plusieurs partenaires menaçant l’éligibilité du projet au financement ainsi que sa viabilité, les lots ne pouvant être assimilés par les partenaires restant. Pour vous y parer, prévoyez une liste de partenaires à intégrer en remplacement des potentiels désistements.
 24 janvier 2019
24 janvier 2019